

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, échange une poignée de main avec le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, à Washington, le 20 mars 2018 (Mandel Ngan/AFP).

L'opposant chinois Liu Xiaobo (à gauche) et sa femme Liu Xia, à Pékin, le 22 octobre 2002 (AFP).
Le pacte faustien de Donald Trump avec l’Arabie saoudite
21 novembre 2018
C’est une palinodie, une de plus, de la part d'un président qui, depuis son entrée en fonctions, en janvier 2017, ne cesse de cultiver – avec une certaine délectation, semble-t-il – l’art du contre-pied. Après avoir menacé de ses foudres l’Arabie saoudite pour le meurtre sordide du journaliste Jamal Khashoggi, le 2 octobre dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul (son corps aurait été démembré à l’aide d’une scie à os avant d’être dissous à l’acide, d’après la presse turque), Donald Trump a finalement tourné casaque.
Dans un communiqué, le locataire de la Maison Blanche a affirmé, mardi 20 novembre, que « les Etats-Unis [entendaient] demeurer un partenaire inébranlable de l’Arabie saoudite ». Et ce, alors même que ses propres services de renseignement ont conclu que le prince héritier Mohammed Ben Salman (surnommé « MBS »), 33 ans, dont feu Jamal Khashoggi était un farouche opposant, était, selon toute vraisemblance, le commanditaire de l’assassinat, perpétré par une escouade d’hommes liges de « MBS ».
Ces propos ont choqué jusque dans les rangs du Parti républicain, auquel Donald Trump appartient. Le sénateur du Tennessee et chef de la puissante commission des affaires étrangères du Sénat, Bob Corker, a écrit sur son compte Twitter : « Jamais je n’aurais pensé qu'un jour la Maison Blanche travaillerait en sous-main comme agence de relations publiques pour le compte du prince héritier d’Arabie saoudite. » « Ce communiqué est “L’Arabie saoudite d’abord, pas l’Amérique d’abord” », a pour sa part raillé le sénateur du Kentucky Rand Paul, en reprenant le slogan fétiche de M. Trump, « America First ».
De fait, un tel revirement est d’autant plus surprenant qu’il y a peu, le même Trump bombait le torse devant les caméras, assurant que si la responsabilité du pouvoir de Riyad était avérée, ce dernier recevrait un « châtiment sévère ». En fait de « châtiment », le royaume wahhabite n’aura eu droit qu’à des admonestations verbales sans conséquences.
A la perspective d’une prise de distance assumée, voire de sanctions franches et durables, le président des Etats-Unis a préféré la continuité. Son argument force ? En maintenant une relation étroite avec l'Arabie saoudite (sunnite), Washington préserve ses intérêts stratégiques au Moyen-Orient, ainsi que ceux de son allié israélien. C’est aussi un moyen, pour l’administration en place, de contrecarrer les ambitions régionales de l'Iran (chiite), pays honni du numéro un américain.
L'aspect économique n'est pas non plus à négliger. A la mi-octobre, en réponse à la question de savoir si son pays envisageait une limitation des ventes d'armes à Riyad, M. Trump avait ainsi déclaré : « Je pense en fait que nous nous punirions nous-mêmes si nous faisons cela. Il y a d’autres choses que l’on peut faire qui sont très, très puissantes, très fortes. » Mais sur la teneur de ces « choses », aucune précision n'a été apportée, signe d’un embarras diplomatique évident.
Le fait est qu'en choisissant de se tenir, quoi qu’il arrive, aux côtés du régime saoudien, Donald Trump lui accorde un dangereux blanc-seing. Déjà tout-puissant en son royaume, dont il tient fermement les rênes même si son père, Salman (82 ans), occupe officiellement le trône, « MBS » devient une sorte d’intouchable.
Pratique pour celui qui s'efforce de focaliser l’attention sur son image de réformateur et de se présenter comme un parangon de modernité à travers quelques mesures phares telles que l'octroi du permis de conduire aux femmes – disposition entrée en vigueur le 24 juin –, la réouverture des cinémas ou le plan « Vision 2030 », ambitieux projet censé briser la trop grande dépendance du royaume vis-à-vis du pétrole et, partant, diversifier son économie.
L'Arabie saoudite, protégée par le parapluie américain depuis février 1945 et le pacte du Quincy – du nom du croiseur USS Quincy, à bord duquel le président américain de l’époque, Franklin Delano Roosevelt, et le fondateur du royaume saoudien, Ibn Saoud, ont scellé leur entente, le premier garantissant au second une protection militaire en échange de son or noir –, a également les mains libres pour poursuivre sa guerre au Yémen.
Déclenché en mars 2015 sur ordre de « MBS », ce conflit, qui met aux prises le gouvernement du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi (soutenu par l’Arabie saoudite) et les houthistes (appuyés par l’Iran), a déjà fait plus de 10 000 victimes, et transformé l’ex-« Arabie heureuse » en mouroir à ciel ouvert. Un tombeau qui a enseveli – et continue d’ensevelir – des êtres sans défense, notamment des enfants. Lesquels sont chaque jour plus nombreux à mourir de faim, dans une indifférence quasi généralisée.
Pourtant – et c’est là une cruelle ironie –, l’Arabie saoudite est membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies ; ces mêmes droits de l'homme qu’elle viole sans vergogne. A cette aune, la politique d’alignement de Donald Trump apparaît à la fois malsaine et malséante. Elle ne fait que prouver l'adage nietzschéen selon lequel « l’Etat est le plus froid de tous les monstres froids ».
De manière unilatérale, le président américain a conclu une sorte de pacte faustien avec Riyad. Mais l’Histoire – comme en septembre 1938 à Munich – a montré que ce genre d’accord funeste ne menait nulle part, sinon à préserver des apparences dépassées et à entretenir l’illusion que de simples déclarations d’intention pouvaient empêcher de basculer dans l’abîme.
Aymeric Janier
Liu Xiaobo, triste symbole de l’implacabilité chinoise
29 juin 2017
Il aura fallu attendre qu’il se trouve aux portes de la mort pour que, enfin, il puisse glaner un maigre espace de vie, si l’on peut dire. Le célèbre opposant chinois Liu Xiaobo, couronné du prix Nobel de la paix en 2010 « pour son long combat non violent en faveur des droits humains fondamentaux en Chine », a été remis en liberté conditionnelle, lundi 26 juin, pour raisons de santé.
Agé de 61 ans, l'intellectuel souffre d’un cancer du foie en phase terminale que les médecins lui ont diagnostiqué à la fin du mois de mai. Il se trouve actuellement dans un hôpital de Shenyang (nord-est), mais sa situation est critique. Sa femme Liu Xia, elle-même assignée à résidence depuis sept ans et privée de presque tout contact avec l’extérieur, a confié que le corps médical « ne [pouvait] ni l'opérer ni lui administrer de radiothérapie ou de chimiothérapie ».
Si M. Liu est considéré par beaucoup comme un « héros » au regard de sa volonté, jamais érodée, de faire éclore la démocratie dans son pays, les hiérarques du Parti communiste (PCC), à l’inverse, voient en lui un dangereux boutefeu qu’il faut réduire à quia par tous les moyens.
Son crime impardonnable ? Avoir appelé en 2008, dans un manifeste baptisé Charte 08 et paraphé par plus de 300 intellectuels, à davantage d’ouverture – rien que de très légal, puisque la Constitution de 1982, en son article 35, dispose que « les citoyens de la République populaire jouissent de la liberté d’expression, de la presse, de réunion, d’association, de défiler et de manifestation ». Pourtant, cette initiative lui a valu en 2009 d’être condamné à onze années d’embastillement pour « incitation à la subversion de l’Etat ».
La Charte 08 postulait en guise de propos liminaire que la liberté, l’égalité et les droits de l’homme constituaient les valeurs universelles communes de l’humanité. « En s’écartant de ces valeurs, le gouvernement chinois a mené une entreprise de “modernisation” qui s’est révélée désastreuse. Elle a dépossédé le peuple de ses droits, annihilé sa dignité et corrompu les rapports humains », écrivaient ses auteurs.
Par suite, ils s’interrogeaient (déjà) fiévreusement sur l’avenir : « Quelle direction la Chine va-t-elle prendre au XXIe siècle ? Va-t-elle poursuivre sa modernisation sous la férule d’un régime autoritaire ou va-t-elle embrasser les valeurs universelles, rejoindre le courant majoritaire et établir un système démocratique ? Ces questions sont incontournables. »
Aujourd’hui, la réponse à ces interrogations est claire : Pékin a choisi la politique du pire, s’enfermant dans un carcan idéologique que rien ni personne ne semble en mesure de briser. Preuve en est, les multiples appels lancés de l'étranger – que ce soit par la Norvégienne Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel, ou par les Etats-Unis – pour accorder à Liu Xiaobo « la liberté de mouvement » et « l’accès aux soins médicaux de son choix » se heurtent systématiquement à une fin de non-recevoir.
Arc-boutée sur ce qu’elle estime être son bon droit, la Chine se refuse à autoriser l’opposant à se rendre à l’étranger pour y être soigné, comme il en a exprimé le souhait, d’après plusieurs de ses proches. L'administration américaine, elle aussi, pousse en ce sens, sans succès pour l'instant. Le PCC reste sourd à toute doléance de ce type, perçue comme une tentative d’immixtion intolérable dans une affaire strictement intérieure.
A la faveur d’un éditorial intitulé « Conspiracy theory surrounding Liu Xiaobo absurd » (« L’absurdité de la théorie du complot entourant Liu Xiaobo ») et publié mercredi 28 juin, le Global Times, proche du PCC, n'a pas de mots assez durs pour fustiger « les forces antichinoises et quelques médias occidentaux » – dont les noms, bien sûr, sont tus.
« A l’avenir, tout ce qui concerne Liu devrait être traité dans le respect de la loi. Les histoires fabriquées de manière perfide pour semer le trouble en Chine ne le guériront pas. Elles ne saperont pas non plus l'ordre juridique », assure le quotidien, bravache. « Ce ne sont que des bulles éphémères qui flottent hors des frontières. Laissons-les vivre leur vie. » Une manière à peine voilée de railler les lubies étrangères.
Malgré l’implacable machine du PCC, qui, à l’automne, renouvellera les sept membres du comité permanent de son Bureau politique – le cœur du pouvoir, aux mains de Xi Jinping depuis 2012 –, Liu Xiaobo a toujours fait face et n’a jamais perdu l’espoir d’un aggiornamento politique.
Sa vie de frondeur, cet ancien étudiant en littérature et philosophie l’a commencée dès 1989, année des manifestations (et du massacre) de la place Tiananmen. A l’époque, il avait encouragé les étudiants à partir plutôt qu’à affronter l’armée.
Lui-même aurait pu fuir et demander l’asile, mais il a préféré rester afin de poursuivre la lutte. Bien que ses ouvrages aient été proscrits et qu’il ait été empêché de poursuivre son activité de maître de conférences, cela n’a en rien altéré son militantisme. Pas plus que les années passées en camp de travail pour avoir critiqué le système de parti unique.
Ainsi que l'a justement souligné Chris Smith, coprésident de la Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine (CECC), le fait que M. Liu ait été libéré n'a rien à voir avec la justice ou un quelconque élan de compassion. Le gouvernement veut seulement s'assurer qu'il ne mourra pas en prison, ce qui écornerait encore un peu plus son image.
Pour un autre opposant bien connu, Hu Jia – en pointe dans les domaines de l'écologie et de la lutte contre le sida –, ce qui se joue porte un nom. Il s’agit d’un « meurtre politique ». Purement et simplement. A l'aune de la réaction du pouvoir, on ne peut que lui donner raison.
Aymeric Janier

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, lors de son discours de Nouvel An, le 1er janvier 2017 (AFP).

Kim Jong-un ou la stratégie de la tension permanente
9 mars 2017
S’il est un domaine dans lequel le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, excelle, c’est celui de la provocation. Lundi 6 mars, en violation patente des résolutions adoptées jusqu’ici par le Conseil de sécurité de l’ONU, le régime de Pyongyang a tiré quatre missiles balistiques en direction de la mer du Japon. Trois d’entre eux se sont abîmés dans la zone économique exclusive (ZEE, à moins de 370 kilomètres des côtes) de l’Archipel, ce qui n’a pas manqué de provoquer l’indignation générale – à commencer par celle, bien compréhensible, de Tokyo.
La Corée du Sud, toujours techniquement en guerre contre sa voisine du nord depuis juillet 1953 et la signature de l’armistice de Panmunjom, a « fermement condamné » ces tirs, cependant que la Chine a appelé à la « retenue » et que les Etats-Unis ont promis d’utiliser « tous les moyens face à cette menace grandissante ».
Reste qu’au-delà de ces réactions de façade, outrées comme à l’accoutumée, les actes peinent à suivre. Comme si chacun des acteurs de cet épineux dossier s’était finalement habitué à subir, à intervalles plus ou moins réguliers, les rodomontades de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, nom officiel de la Corée du Nord).
Celle du 6 mars est-elle liée aux manœuvres militaires annuelles menées conjointement par Séoul et Washington (exercices « Key Resolve » et « Foal Eagle »), que Kim et ses affidés considèrent comme la répétition générale d’une future invasion ? Peut-être.
Quoi qu’il en soit, le despote de Pyongyang sait matoisement (sur)jouer de la puissante force d’inertie qui semble paralyser ses adversaires. Ses bravades ne sont pas nouvelles. En un peu plus de dix ans, la Corée du Nord a déjà procédé à cinq essais nucléaires, en octobre 2006, mai 2009, février 2013 et, plus récemment, en janvier et septembre 2016.
Depuis l’an dernier, toutefois, la hardiesse du régime paraît s’être accentuée. Rien qu’en 2016, en effet, plus de vingt tests de missiles balistiques ont été conduits. Dans son discours prononcé à l’occasion du passage à 2017, Kim Jong-un est allé plus loin, assurant que son pays « en était aux préparatifs finaux avant le premier test d’un missile balistique intercontinental », engin dont la portée supérieure à 5 500 kilomètres permettrait en théorie d’atteindre le territoire américain.
« La Corée du Nord est désormais une puissance militaire de l’Orient que même le plus puissant des ennemis ne pourrait toucher », s’était-il rengorgé. Des propos distillés à dessein, à quelques jours de l’investiture du nouveau président (républicain) des Etats-Unis, Donald Trump, dont le satrape voulait sans doute tester la réaction...
En maintenant une stratégie de la tension permanente, le dirigeant nord-coréen n’aspire qu’à un objectif : se maintenir au pouvoir à n’importe quel prix. Cette posture s’adresse autant à la communauté internationale qu’à ses compatriotes, qu’il maintient depuis la mi-décembre 2011 sous un joug sanglant – n’a-t-il pas fait exécuter en décembre 2013 son propre oncle, Jang Song-thaek, fusillé à la mitrailleuse lourde antiaérienne puis incinéré au lance-flammes pour « trahison » ? Dans les deux cas, il s’agit d’exhiber force et intransigeance pour obvier à toute velléité d’attaque ou de remise en question. Statufier le régime, en quelque sorte.
La clé de résolution de la problématique nord-coréenne est probablement à chercher dans une éventuelle entente sino-américaine. Mais les deux grandes puissances, elles-mêmes rivales par ailleurs aux niveaux économique et géostratégique, le peuvent-elles et surtout le veulent-elles ? Rien n’est moins sûr.
Le gouvernement Trump vient de rejeter un compromis proposé par Pékin – bailleur et protecteur de la RPDC – prévoyant que la Corée du Nord suspende son programme nucléaire à finalité militaire (né au début des années 1980) en échange de l’arrêt des manœuvres américano-coréennes pour éviter une « collision » entre les deux Corées.
Par la voix de Geng Shuang, porte-parole du ministère des affaires étrangères, la Chine a pour sa part insisté sur le fait qu’elle défendrait « résolument » sa sécurité en réponse au déploiement du bouclier antimissile américain Thaad en Corée du Sud, lui-même mis en place après les tirs de missile nord-coréens. Quadrature du cercle...
En digne héritier de son père, Kim Jong-il (1941/1942-2011), et de son grand-père, Kim Il-sung (1912-1994), Kim Jong-un sait exploiter la moindre faille à son profit. Et les tâtonnements diplomatiques incessants de la communauté internationale, incapable de s’entendre sur un discours de la méthode – faut-il privilégier une approche traditionnelle (diplomatie, dissuasion), non conventionnelle (cyberguerre), voire un mélange des deux ? –, le servent à merveille.
Pour l’heure, l’atmosphère sur la péninsule ressemble en tout cas à s’y méprendre à la formule lapidaire que le philosophe et sociologue Raymond Aaron utilisait en son temps pour décrire l’équilibre précaire de la guerre froide : « Paix impossible, guerre improbable ».
Aymeric Janier

Le président russe, Vladimir Poutine (à gauche), et le premier ministre japonais, Shinzo Abe, lors d'une conférence de presse commune à Tokyo, le 16 décembre 2016 (Franck Robichon/AFP).

Les îles Kouriles et les limites de l'entente russo-japonaise
19 décembre 2016
C'est un nœud gordien qui, en dépit de tractations feutrées, n'a jamais été tranché. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le contentieux des îles Kouriles (méridionales), administrées par la Russie mais revendiquées par le Japon sous le nom de « Territoires du Nord » au sud de la péninsule du Kamchatka, empoisonne les relations entre Moscou et Tokyo. Au point qu'il a toujours empêché les deux pays voisins, aujourd'hui confrontés à la montée en puissance de la Chine, de signer un traité de paix formel.
Le déplacement officiel de Vladimir Poutine à Nagato (sud), les jeudi 15 et vendredi 16 décembre – sa première visite sur l'Archipel depuis onze ans – aurait pu faire bouger, même modestement, les lignes. Las ! Hormis une déclaration minimaliste sur le renforcement des liens économiques bilatéraux et le développement « d'activités conjointes » (pêche, tourisme, environnement), la tendance fut à un immobilisme calculé.
De fait, au-delà d'une trentaine de projets de coopération dans les domaines de l'énergie, de la médecine et de la haute technologie, aucune avancée tangible n'a été enregistrée. La perspective d'un accord sur la base de la déclaration commune du 19 octobre 1956 a été, ainsi que l'a annoncé le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, repoussée à de « futures négociations ».
Ladite déclaration prévoyait à l'origine que l'URSS rétrocédât au Japon les deux îles les plus proches du Japon – à savoir Habomai (inhabitée) et Chikotan (environ 2 000 habitants) – dès lors qu'un traité de paix serait paraphé. Ce qui n'est jamais advenu. Dans leurs propos respectifs, le président russe, Vladimir Poutine, et le premier ministre conservateur japonais, Shinzo Abe, ont, sous le sceau de l'urbanité, campé sur leurs positions.
« Il faut tenir compte de l'Histoire et de la situation des habitants (de ces îles) », a insisté le premier. « Nous avons accompli un premier pas important (...) avec l'accord sur les activités conjointes, mais elles ne doivent pas porter atteinte à la position de principe du Japon », a rappelé le second. Une manière, pour les deux dirigeants, de laisser entendre que, s'ils ne sont pas hostiles à un rapprochement, celui-ci ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Aucun d'eux n'aspire à passer sous les fourches Caudines de l'autre.
Pourquoi, au fil des années, aucun compromis raisonnable n'a-t-il été scellé ? Cela tient autant à l'hubris des deux parties qu'à des considérations stratégiques. Pour les Russes, le territoire fait partie du discours national sur la victoire arrachée aux nazis en 1945, à l'issue de la « Grande Guerre patriotique » – le vocable par lequel l'URSS désigna le conflit l'ayant opposée aux forces d'Adolf Hitler, de juin 1941 à mai 1945.
Un monument dédié aux soldats de l'Armée rouge a d'ailleurs été érigé à Kounachir, l'une des quatre îles des Kouriles méridionales, où Dmitri Medvedev avait été le premier président russe de l'ère moderne à se rendre, en novembre 2010. Sa visite éclair d'à peine quatre heures avait suscité l'ire des hiérarques japonais, qui, en signe de protestation, avaient convoqué l'ambassadeur de Russie à Tokyo, Mikhaïl Bely. Lequel s'était défendu en arguant qu'il s'agissait d'une « affaire intérieure russe ».
Les opposants russes à tout accommodement font valoir que la zone serait riche en ressources halieutiques, mais aussi potentiellement en réserves pétrolières et gazières, ainsi qu'en gisements d'or et d'argent. Ils tirent en sus argument du fait qu'elle permettrait de sanctuariser la mer d'Okhotsk, d'une importance capitale pour la flotte russe du Pacifique.
Les nationalistes japonais, pour leur part, considèrent que le retour des îles dans leur giron serait une étape essentielle pour restaurer la dignité perdue de l'ancien empire du Soleil-Levant. Avant que Staline ne les annexât, en 1945, elles appartenaient en effet au Japon, en vertu du traité de Shimoda du 7 février 1855. Depuis son retour au pouvoir, en décembre 2012, Shinzo Abe n'a pas ménagé ses efforts en ce sens.
« Cette question sera réglée sous ma génération. J'y veillerai personnellement », a assuré celui dont le père, Shintaro Abe, avait échoué à trouver un consensus avec Mikhaïl Gorbatchev, lorsqu'il dirigeait la diplomatie japonaise, de 1982 à 1986. En avril 2013, déjà, il avait déclaré, en plantant un sakura (cerisier ornemental du Japon) lors d'une halte au jardin botanique principal de l'Académie des sciences de Russie, à Moscou : « En accord avec la volonté de mon père, je souhaite que les relations avec la Russie parviennent à un stade où les cerisiers seront en pleine floraison. » Une métaphore on ne peut plus explicite.
Il est cependant peu probable qu'un règlement définitif intervienne à court terme. Depuis l'annexion à la hussarde de la Crimée, au printemps de 2014, Vladimir Poutine s'est forgé une image de protecteur des terres russes à laquelle il n'entend pas déroger. De surcroît, le fait que la Russie soit revenue sur l'avant-scène diplomatique à la faveur du drame syrien n'incite guère à penser que le chef du Kremlin puisse être plus enclin à la compromission ou à de subtiles blandices qu'il ne l'a été depuis l'aube de son troisième mandat, en mai 2012.
Au contraire, il se sait en position de force et n'a donc aucune raison de renoncer à un tel avantage. Ce qui laisse à des Japonais certes alliés des Américains mais bien seuls sur le dossier des Kouriles (Washington s'intéresse davantage à la mer de Chine méridionale) une marge de manœuvre des plus ténues.
Aymeric Janier

Saad Hariri (à gauche) félicite le nouveau président Michel Aoun après sa désignation par la Chambre des députés, à Beyrouth, le 31 octobre 2016 (service de presse du Parlement libanais).
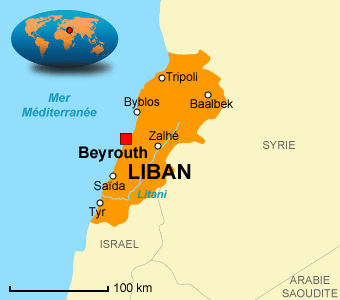

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, s’entretient avec le président américain, Barack Obama, à New York, le 21 septembre 2016 (Jim Watson/AFP).
Au Liban, fin du vide institutionnel, pas des divisions
3 novembre 2016
C'est la fin de la politique du vide et, en un sens, du pire. Après vingt-neuf mois de vacance au sommet de l'Etat, le Liban s’est enfin doté, lundi 31 octobre, d’un nouveau président en la personne de l’ancien général chrétien Michel Aoun. Il aura fallu quarante-six séances électorales pour que les députés parviennent à s’accorder sur un nom.
A 81 ans, le fondateur du Courant patriotique libre, soutenu par le parti-milice chiite du Hezbollah – dont il fut un adversaire acharné jusqu’en 2006 –, a été désigné au second tour de scrutin, avec 83 voix sur 127, un choix qui met fin à une longue période d’incertitude ouverte à la fin du mandat de Michel Sleimane, un autre général, le 25 mai 2014.
Le poste de premier ministre, lui, est échu au sunnite Saad Hariri, 46 ans et rallié à M. Aoun « par défaut » pour des questions d’isolement politique et de difficultés financières. Au Liban, la tradition, qui s’appuie sur un pacte national forgé en 1943 au moment de l’indépendance vis-à-vis de la France, veut que la présidence de la République revienne à un chrétien maronite, celle du gouvernement à un musulman sunnite et celle de la Chambre des députés (Parlement) à un musulman chiite. D'où un écheveau souvent complexe à démêler.
Ce déblocage institutionnel, bien qu'encourageant sur le papier, n’augure pourtant pas d’un rapprochement entre partis. Il s’apparente davantage à un mariage de circonstance, dont, au reste, tout laisse à penser qu’il va être très rapidement mis à l’épreuve. Principal abcès de fixation : la Syrie.
Dans son discours d’investiture, Michel Aoun, ancien commandant en chef des Forces armées libanaises pendant la guerre civile (1975-1990), s'est engagé à combattre le terrorisme. Surtout, il a promis d’empêcher les « feux » qui consument la région de se propager. Une référence implicite au conflit qui se joue chez son voisin. Mais, face au régime alaouite (une branche du chiisme) de Bachar Al-Assad, les postures des uns et des autres sont pour le moins antagonistes et, partant, difficilement conciliables à terme.
Là où le Hezbollah soutient de manière indéfectible le maître de Damas, auquel elle fournit d’ailleurs un appui militaire sur le terrain, Saad Hariri, chef du Courant du futur, veut sa chute. D'autant qu'il l'accuse d'être responsable de la mort de son père, Rafic Hariri. L’ancien premier ministre avait été tué le 14 février 2005 dans un attentat à la camionnette piégée, alors qu'il circulait à bord d’une voiture blindée sur le front de mer de Beyrouth.
Soucieux de ménager un certain équilibre, Michel Aoun a tenté de prendre ses distances, et peut-être de la hauteur, en se focalisant sur les questions migratoire et sécuritaire. Il a ainsi affirmé que, quelle que soit la solution apportée à la guerre syrienne, qui fait rage depuis 2011, elle devrait garantir le retour des réfugiés installés sur le sol libanais, dont les autorités estiment le nombre à 1,5 million (qui s’ajoutent aux 4,3 millions d’habitants du pays). Les camps syriens au Liban ne doivent pas se muer en repaire de militants, a-t-il prévenu.
Le nouveau chef de l’Etat, qui avait été lui-même chassé du palais présidentiel de Baabda en 1990 par l'armée d’Hafez Al-Assad, père de Bachar, sait certainement tout le bénéfice qu’il y a à ne pas laisser sciemment le doigt dans l’engrenage syrien. Mais rien n’indique que ses soutiens soient disposés à le retirer de sitôt. A commencer par le Hezbollah d’Hassan Nasrallah, qui y trouve son intérêt et dont le pouvoir se renforce.
Avec l’accession de Michel Aoun à la présidence pour six ans non renouvelables, le « Parti de Dieu », courroie de transmission de l'Iran au pays du Cèdre depuis 1982, réalise de fait une très belle opération et voit du même coup son influence consolidée.
A travers lui, et c'est là l'un des autres points de crispation qui se profile, Téhéran engrange également un beau succès aux dépens de son rival saoudien, totalement absent. Ce n'est pas un hasard si, peu après la nomination de Michel Aoun, le président iranien, Hassan Rohani, s’est empressé de le féliciter. « Vous prenez vos fonctions alors que la région fait face à une double menace : les groupes terroristes et l’avidité du régime sioniste (comprendre Israël). Nous sommes certains qu’avec votre élection, le front de la résistance sera renforcé face à ces deux menaces », lui a-t-il dit.
Pas sûr que le sunnite Saad Hariri, qui a déjà occupé le siège de chef du gouvernement de 2009 à 2011, voie d’un très bon œil la poussée de cet axe Hezbollah-Iran-Syrie. Plus largement, cela risque également de froisser l’Occident et ses alliés arabes, qui ont pris fait et cause contre Bachar Al-Assad, perçu comme le massacreur de son propre peuple.
Dans un communiqué au ton prudent, la diplomatie américaine s’est contentée de « féliciter le peuple du Liban » – une tournure suffisamment vague pour ne pas donner l’impression de cautionner le Hezbollah, que Washington considère comme une organisation terroriste.
A présent, Saad Hariri, à qui les partis prosyriens ont refusé d’accorder leur confiance, va devoir composer une équipe mêlant différentes sensibilités et capable de régler les nombreux défis auxquels le pays est confronté (relance de l’économie, éradication de la corruption et du clientélisme, renforcement de l’appareil sécuritaire).
Une tâche qui s’annonce ardue. Il n’y a qu’à voir, pour s’en convaincre, l’attitude de Nabih Berri. Farouchement opposé au tandem Aoun-Hariri, le président de la Chambre des députés et chef du parti chiite Amal, a déjà annoncé qu’il ne ferait pas partie du futur cabinet. Les prémices, sans doute, d’une nouvelle guerre de tranchées...
Aymeric Janier
Des limites de l’alliance américano-israélienne
24 septembre 2016
Vu de l'extérieur, cela ressemblait à une parfaite mise en scène. Poignée de main chaleureuse, sourires enjôleurs, assauts de politesse devant les caméras : tout y était, tiré au cordeau jusque dans les moindres détails. La dernière rencontre officielle entre le président américain, Barack Obama, et le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, mercredi 21 septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, fut un modèle très réussi de diplomatie calculée. Avec, en toile de fond, un objectif : démontrer qu'entre Washington et Tel-Aviv, la relation demeure au beau fixe en dépit des nuages qui se sont amoncelés au-dessus du partenariat bilatéral ces dernières années.
Avant même que n'intervînt cet élan (mesuré) de cordialité réciproque, les Etats-Unis avaient préparé le terrain. La semaine dernière, le gouvernement Obama a ainsi alloué une enveloppe de 38 milliards de dollars d'aide militaire à l'Etat hébreu sur dix ans, « le plus important engagement d'assistance militaire bilatérale dans l'histoire des Etats-Unis », selon les termes employés par le département d'Etat américain. Une hausse sensible par rapport à l'accord actuel (30 milliards de dollars sur dix ans), qui doit expirer en 2018.
A l'approche de la fin de son second mandat, Barack Obama, dont le modus vivendi avec Benyamin Nétanyahou a toujours été empreint de défiance (leurs sensibilités, démocrate « progressiste » pour l’un, conservatrice pour l’autre, s’accordent mal), ne s'est pas contenté d'exprimer sa munificence par des actes, mais aussi par des paroles pesées au trébuchet.
« Notre alliance avec Israël est fondée sur des valeurs communes et la reconnaissance du fait qu’il est l’un de nos alliés les plus importants », a expliqué le locataire de la Maison Blanche, évoquant un « lien indissoluble ». « Israël n’a pas de meilleur ami que les Etats-Unis », lui a répondu, en écho, le chef du Likoud [le parti de droite israélien, fondé en 1973 par Menahem Begin].
Certes, l’unité n'est pas un vain mot. Elle puise aux sources d’une histoire commune très riche, et ce dès la création d’Israël, le 15 mai 1948 – reconnue le jour même par le président américain d’alors, Harry S. Truman. Mais deux « hiatus diplomatiques » tendent aujourd’hui, sinon à la fissurer, du moins à l’obscurcir.
L'actuelle administration américaine estime que la construction récurrente de colonies de peuplement en Cisjordanie (appelée Judée-Samarie en Israël, en référence à l'aspect biblique de ce territoire) est un obstacle à l’aboutissement du processus de paix israélo-palestinien. Or, la « solution à deux Etats » vivant côte à côte a toujours été privilégiée par Barack Obama.
Dans son allocution du Caire du 4 juin 2009, intitulée « Un nouveau départ » et prononcée cinq mois après le début de son premier mandat, il l’avait exprimé sans ambages. « L’Amérique ne tournera pas le dos à l’aspiration légitime du peuple palestinien à la dignité, au progrès et à un Etat qui lui est propre », avait-il déclaré, tout en prenant soin d'évoquer également le « passé tragique » du peuple juif.
A l’époque, Benyamin Nétanyahou, qui avait lui-même discouru quelques jours plus tard à l’université Bar-Ilan de Tel-Aviv, ne s’était pas, sur le principe, opposé à cette idée, sous réserve que le futur Etat palestinien fût démilitarisé et disposé à reconnaître Israël comme l’Etat du peuple juif. Cette convergence de vues paraît aujourd’hui appartenir à une ère révolue. Preuve en est, aucune nouvelle initiative n’a vu le jour depuis l'échec de la dernière médiation mise en place par le secrétaire d’Etat américain John Kerry, au printemps 2014.
Du côté d’Israël, l'accord sur le nucléaire iranien, conclu à la mi-juillet 2015 à Vienne, entre Téhéran et le groupe dit des « 5 + 1 » (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), a été vécu comme un baiser de Judas. Une trahison ressentie d’autant plus douloureusement que la République islamique voue l’Etat hébreu aux gémonies et à la destruction depuis la révolution khomeyniste de 1979.
« Pensez-vous réellement que des centaines de milliards de dollars en allègement de sanctions et contrats juteux vont faire de ce tigre rapace un gentil chaton ? Si tel est le cas, vous devriez y réfléchir à deux fois », avait lancé Benyamin Nétanyahou à la tribune de l’ONU, en octobre 2015, en dénonçant avec virulence les « intentions génocidaires » du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khameneï [en fonction depuis 1989].
En août, le ministre (russophone) de la défense israélien, Avigdor Lieberman, connu pour ses saillies ultranationalistes, a lui-même comparé l’accord de Vienne à celui de Munich, scellé en septembre 1938 entre Hitler, Mussolini, Chamberlain et Daladier – une manière on ne peut plus explicite de conspuer la capitulation des grands face à une nouvelle forme de fascisme nihiliste.
« Colonisation » contre nucléaire iranien : ces griefs mutuels empêchent Américains et Israéliens d’être pleinement en phase. Reste une question : que va faire Barack Obama de ses ultimes semaines au pouvoir ? Soucieux de ne pas laisser derrière lui un héritage vierge sur le dossier israélo-palestinien – l’une des principales ombres au tableau de ses huit années de présidence – va-t-il tenter un dernier coup de poker au Conseil de sécurité pour tordre le bras de l’Etat hébreu ? Les hiérarques israéliens le redoutent.
Malgré ses faiblesses, malgré ses imperfections, le tandem américano-israélien demeure solide. Et, quel que soit le futur dirigeant des Etats-Unis, il a tout intérêt à ce que cela dure. Car le Moyen-Orient regorge de défis – guerre en Syrie, menace de l’autoproclamé Etat islamique, paralysie politique au Liban, entre autres – face auxquels Washington et Tel-Aviv ont résolument besoin l'un de l'autre pour avancer.
Aymeric Janier

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'exprime pendant la tentative de coup d’Etat à Istanbul, le 16 juillet 2016 (Huseyin Aldemir/Reuters).
Cliquez sur l'icône pour télécharger la version anglaise de l'article
Click on the icon to download the English version of the article
Turquie : coup d’Etat avorté, Erdogan renforcé
18 juillet 2016
C’est peut-être l’étincelle qu’il attendait pour alimenter un peu plus le feu de la répression. En sortant vainqueur de la tentative de coup d’Etat perpétrée, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 juillet, par une faction minoritaire de l’armée turque, au prix d’un lourd bilan (plus de 290 morts et 1 400 blessés), le président, Recep Tayyip Erdogan, a prouvé à ses ennemis et contempteurs qu’il n’était pas près de céder une once de pouvoir, quand bien même les accusations – fondées – de « dérive autoritaire » se multiplient à son endroit.
De fait, après treize années de gouvernance, d’abord en qualité de premier ministre (2003-2014), puis en tant que premier chef de l’Etat élu au suffrage universel direct, le « sultan » d’Ankara paraît avoir retrouvé un nouvel élan, lui que d’aucuns disaient à bout de souffle après une année 2015 agitée, au cours de laquelle il avait, pour la première fois de son « règne », perdu sa majorité absolue (de juin à novembre).
Le pronunciamiento manqué du 15 juillet, dont l'amateurisme est saisissant en regard des coups d’Etat de 1960, 1971, 1980 – bien mieux organisés car dirigés par une armée unie, soudée autour de la défense du kémalisme –, lui offre même l’occasion de consolider son assise, laquelle est ébranlée depuis 2013 par des accusations récurrentes de corruption.
Cet épisode éclair a permis au chef de l’Etat de mobiliser ses soutiens et, ce faisant, de rappeler qu’une partie non négligeable des Turcs se tenait toujours à ses côtés. A Ankara comme à Istanbul, les démonstrations de force des militants de l'AKP (le Parti de la justice et du développement, islamo-conservateur) et des sympathisants du régime en ont apporté une preuve indéniable.
Fort de cette base qu’il sait solide, notamment dans les milieux populaires (la plupart des intellectuels, eux, le considèrent comme un despote mégalomane), Recep Tayyip Erdogan a les mains libres. Cela le poussera-t-il à poursuivre, voire accentuer, sa politique punitive vis-à-vis de ceux qui se dressent en travers de sa route ?
La question est légitime car de vastes « purges » ont déjà commencé dans les cercles militaires. Un coup de filet opportun, qui concerne au total plus de 6 000 personnes, dont une centaine de généraux et d'amiraux issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la Marine. Près de 3 000 mandats d'arrêt ont également été délivrés à l'encontre de juges et de procureurs. Ce ratissage, qui n’en est sans doute qu’à ses prémices, n’est pas fortuit : l’armée et la justice représentent en effet deux pôles d’influence où se nichent les plus farouches opposants au projet « d’hyperprésidentialisation » d’Erdogan.
Pour asseoir son autorité, ce dernier sait instrumentaliser à son profit l’un des artifices majeurs de la guerre : la diversion. Quoi de mieux, lorsque l'on est sous pression, que de détourner l’attention en brandissant l’épouvantail d’une menace extérieure ? La fièvre obsidionale, comme chacun sait, est un ressort puissant en temps de crise. En l'occurrence, Recep Tayyip Erdogan a trouvé le parfait « alibi » : Fethullah Gülen.
Naguère proche d’Erdogan, à qui il fournissait de larges bataillons de voix en période électorale, ce prédicateur de soixante-quinze ans est aujourd'hui sa bête noire. Un contentieux personnel né d’un scandale d’écoutes téléphoniques ayant révélé des faits de prévarication au plus haut sommet de l’Etat et dans lequel Erdogan a vu la main invisible des gülenistes, parfois qualifiés de « jésuites de l'islam ».
Régulièrement, le président turc accuse l'imam de mener, à travers son courant – très introduit dans tous les grands corps (l’armée, la justice, la police) –, une sorte d’« Etat parallèle » et de vouloir sa chute. Ce que l’intéressé dément à toute force depuis la Pennsylvanie (nord-est des Etats-Unis), où il est exilé depuis 1999 du fait de son opposition aux militaires, jadis omnipotents dans le pays.
Pas de quoi cependant tempérer l’ardeur d’Erdogan, qui, soucieux d’avoir les coudées franches pour se tailler une Constitution à sa main, a promis d’éliminer ce rival embarrassant. Il a d’ailleurs enjoint aux autorités américaines de l'extrader. En pure perte jusqu’à présent, Washington n’ayant pas l’intention de se soumettre au diktat de son partenaire, du reste l'un de ses proches alliés au sein de l'OTAN (à laquelle la Turquie appartient depuis 1952).
Après avoir amorcé il y a peu un mouvement de réconciliation avec Israël et la Russie, renouant en cela avec la doctrine du « zéro problème avec les voisins » chère à l’ancien premier ministre Ahmet Davutoglu – écarté de son poste en mai pour cause de... différend avec Erdogan –, le chef de l’Etat turc cherche à pousser son avantage sur le plan intérieur. Il n'a d'ailleurs pas tardé à évoquer, devant ses partisans, le possible rétablissement de la peine de mort, abolie en 2004.
Pour l’heure, sa stratégie de reprise en main fonctionne car il profite de l'extrême polarisation de l'électorat (les citoyens les plus pieux et les plus conservateurs demeurent acquis à sa cause) et du morcellement de l’opposition, laquelle s’est désolidarisée du coup d’Etat, à l'image du Parti républicain du peuple (CHP, laïc et kémaliste) et du Parti démocratique des peuples (HDP, pro-kurde), parlant d'une seule voix – une première dans l'histoire récente.
Mais son appétence pour une certaine forme d’absolutisme politique, qu’atteste l’étranglement progressif des libertés (musellement de la presse, encadrement étroit des réseaux sociaux, condamnations à répétition pour « insulte » envers sa personne) au mépris de l'attachement du peuple à la démocratie, pourrait bien, à terme, se retourner contre lui. Et, s’il n’y prend pas garde, à créer une jonction entre l’armée et la société civile qui, cette fois, lui serait fatale.
Aymeric Janier