

2017 : le pire des mondes ?
10 septembre 2017
C’est une antienne que l’on a coutume d’entendre ad nauseam dans la bouche de commentateurs et d’observateurs peu scrupuleux : en 2017, la planète regorgerait de périls, du reste beaucoup plus nombreux qu’à l’époque de nos ancêtres. Une affirmation péremptoire brandie, à grand renfort d’arguments parfois fallacieux, comme une vérité irréfragable. Mais qu’en est-il en réalité ? N’est-ce pas aller trop vite en besogne ?
Dans Notre monde est-il plus dangereux ? (1), ouvrage qui vient de paraître aux Editions Armand Colin, un panel de spécialistes rassemblés autour de Sonia Le Gouriellec, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (Irsem), s’efforce de déconstruire ce mythe tenace à travers des exemples précis.
Par le biais de vingt-cinq fiches didactiques, les auteurs, venus d’horizons très divers – d’aucuns sont analystes, d’autres consultants, d’autres encore historiens ou journalistes – aspirent à donner du sens à une actualité géopolitique qui, dans la plupart des cas, est présentée de manière schématique, dépouillée à l’extrême de tout ce qui en fait pourtant le sel.
Leur volonté, comme ils l’expliquent eux-mêmes en guise de prolégomènes, n’est pas tant de promouvoir une forme de « despotisme des experts » que de remettre les choses en contexte afin de ne pas tomber dans l’ornière des généralisations hâtives.
En ce sens, l’exercice est réussi. Ces fiches, outre le fait de battre en brèche stéréotypes, raccourcis et autres idées convenues, donnent des clés de compréhension factuelles pour mieux permettre à chacun de se faire son opinion. Elles éclairent aussi le présent à la lumière des événements passés – cheminement qui, trop souvent, est négligé.
A ce titre, on signalera l’intérêt que présentent les fiches 12 (« Pourquoi un affrontement direct entre l’Arabie saoudite et l’Iran est-il improbable ? »), 18 (« Faut-il avoir peur de la Corée du Nord ? »), 21 (« La Françafrique est morte, vive la Françafrique ? ») et 22 (« L’Afrique est-elle rongée par les guerres ethniques ? »).
Difficile, voire impossible, en effet de mesurer les enjeux liés à ces thématiques sans disposer d’un certain référentiel historique. Comment comprendre la lutte d’influence farouche que se livrent Riyad et Téhéran sans évoquer les basculements fondamentaux de 1979 (révolution iranienne, sous l’égide de l’ayatollah Khomeyni) et 2003 (invasion de l’Irak par les Etats-Unis) ? Comment saisir la problématique nord-coréenne sans évoquer le nationalisme coréen exacerbé du régime de Pyongyang ? Comment maîtriser la question de la politique française en Afrique sans expliciter le poids des réseaux Foccart – du nom de Jacques Foccart, le « Monsieur Afrique » du général de Gaulle et de Georges Pompidou ?
Outre le fait d’aborder des sujets complexes de façon raisonnée – en laissant de côté tout affect, prisme par essence déformant –, le grand mérite de cet opuscule est de poser des questions qui bousculent les grilles de lecture préétablies. « Les terroristes sont-ils des barbares, fous et idiots ? » (fiche 2), « Armées partout, terrorisme nulle part ? » (fiche 3) ne sont que des exemples parmi d’autres. Des interrogations qui amènent à observer sans fard une réalité qui, pour dérangeante qu’elle soit, ne saurait être niée.
Non, tous les djihadistes n’appartiennent pas à la caste des psychopathes à l’esprit délirant. Il se trouve aussi, parmi eux, des idéologues de l’ombre qui, de manière tout à fait rationnelle, cherchent à promouvoir par la propagande une vision d’un monde inféodé à l’islam. Ainsi du Syrien Abou Moussab Al-Souri et de l’Egyptien Abou Bakr Naji, auteurs respectivement, en 2004, de L’Appel à la résistance islamique mondiale et Management de la sauvagerie : l’étape la plus critique que franchira l’Oumma (l’oumma désigne la communauté des croyants).
Et non, le « risque zéro » face à la menace des reîtres de l’islamisme radical n’existe pas. Preuve en est, la mise en place, au lendemain des attentats de janvier 2015, de l’opération Sentinelle n’a pas permis de faire pièce à d’autres attaques – le 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, le 14 juillet 2016 à Nice... Et ce, même si 7 000 à 10 000 militaires (selon les périodes) sont mobilisés sur le terrain pour sécuriser les lieux à forte fréquentation de population, à l’instar des gares et des aéroports. Cela soulève, par ricochet, un autre débat : celui de l’adaptation des modes d’action face à une guerre d’attrition asymétrique.
Sonia Le Gouriellec et ses collègues ont aussi fait le choix de s’aventurer au-delà du simple périmètre de l’actualité géopolitique pour explorer d’autres champs de recherche. Une initiative d’autant plus nécessaire et salutaire que, de nos jours, les extensions du domaine des relations internationales sont légion.
Stratégie et philosophie sont ainsi abordées – une manière de satisfaire tant les connaisseurs du théoricien militaire prussien Carl von Clausewitz (1780-1831) que les férus de Jacques Derrida (1930-2004), tous deux mentionnés au fil des pages.
Fluide et agréable à lire, l’ouvrage ne se perd pas en détails superfétatoires. Le parti pris est d’ailleurs inverse, avec des approches ciselées, au risque de laisser çà et là un goût d’inachevé, comme sur le « modèle de sécurité » israélien (comment l’Etat hébreu l’a-t-il développé ? Quels outils emploie-t-il pour protéger ses citoyens ?).
Autre bémol : le livre, s’il évoque abondamment l’Afrique et, dans une moindre mesure l’Asie, fait en revanche l’impasse sur d’autres espaces géographiques, à l’instar du continent américain – exception faite des Etats-Unis.
Il n’en demeure pas moins qu’en définitive, les auteurs ont su éviter l’écueil de la vulgarisation partiale. Et rester fidèle à la promesse faite en introduction de leur livre, avec les mots de Charles Péguy : « Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise pensée, c’est d’avoir une pensée toute faite. »
Aymeric Janier
(1) Notre monde est-il plus dangereux ?, Editions Armand Colin (collection Idées claires), septembre 2017, 160 pages.

Sur la route avec les migrants mexicains et leurs espoirs
9 novembre 2015
Qu'elle vienne d’Afrique du Nord, de « l’Orient compliqué » ou d’ailleurs, l'immigration charrie immanquablement dans son sillage peurs, négativité et préjugés. Pour beaucoup, elle représente, au mieux une nuisance, au pire un dangereux Léviathan. Afin de comprendre les ressorts du phénomène migratoire, le journaliste américain Ted Conover a passé un an aux côtés de clandestins mexicains désireux de rallier les Etats-Unis.
Une expérience immersive d’une rare intensité, dont il a tiré un récit captivant, Les Coyotes (1), ce nom informel donné aux passeurs qui monnaient leurs services, parfois au prix fort, de part et d'autre de la frontière américano-mexicaine. Ni « apologie », ni « plaidoyer », comme l’auteur l’explique en guise d’avant-propos, son ouvrage, dénué de tout accent politique, se veut un moyen de saisir sur le vif, de l'intérieur, la réalité de l’immigration. Avec un parti pris assumé : mettre toute polémique sous le boisseau au profit de « l’humain ».
Alonso, Carlos, Emilio, Maximo... Au fil des pérégrinations inattendues, et parfois cocasses, de ces personnages émouvants, Ted Conover livre un témoignage unique, à la fois déstabilisant et truculent. Il donne à voir, sans filtre, les difficultés et le sacrifice de ceux qui tentent de rejoindre El Norte, cet ailleurs révéré comme un eldorado où tout semble possible.
Vouloir pénétrer au pays de l’Oncle Sam, c’est se confronter à un univers interlope, froid et oppressant, avec ses codes, ses usages, son vocabulaire aussi. L’occasion de faire connaissance avec los mojados – ces « dos mouillés », ainsi surnommés pour avoir traversé le Rio Grande à la nage –, los pollos – les « poulets », clients des coyotes – ou la migra, les tout-puissants services de l’immigration, Némésis des migrants en transhumance.
Dans ce monde clos et amoral, les passeurs, organisés en mafia souterraine, règnent en maîtres. Ecumant les gares routières du nord du Mexique, de jour comme de nuit, en quête de sans-papiers à acheminer « de l’autre côté », ce sont eux qui fixent les règles et supervisent le trafic illégal d’êtres humains. Brutalité, duperie et racket sauvage constituent leur fonds de commerce. Et malheur à ceux qui essaient de se soustraire à l'ordre établi !
A cette menace s’ajoute celle, plus diffuse encore, de la police judiciaire, volontiers adepte de la prévarication et de la torture envers les clandestins soupçonnés de verser dans le narcotrafic. Sa méthode favorite ? Le tehuacanazo, technique locale consistant à maintenir la tête de la victime en arrière, une main plaquée sur sa bouche, puis à déverser de l’eau pétillante dans ses narines jusqu’à ce qu’elle inonde ses sinus...
Durant son périple au long cours, qui, il le confesse, n’a pas été sans risques, Ted Conover s’est à ce point fondu parmi les indocumentados qu’il a partagé leur fardeau quotidien – à commencer par la redoutable cueillette d’oranges en Arizona – et leurs déboires. Difficulté de s'inventer un avenir au jour le jour lorsque l’on est désargenté, d'éviter les chausse-trapes d'une terra incognita, mais aussi de laisser derrière soi le clan familial, considéré comme sacré au Mexique.
De fait, chaque départ, motivé par l’espoir d’une vie meilleure, crée une césure parfois irréversible au sein des familles. Certains hommes, « fortune » faite, rentrent au pays, mais d’autres ne reviennent qu’une fois par an, voire pas du tout. Les jeunes, abreuvés des récits « glorieux » de leurs aînés (qui, souvent, s’apparentent davantage à des fiascos), aspirent à suivre la même voie, fût-elle cahoteuse et semée d’embûches. C’est ce qu’a constaté Ted Conover.
La principale force de son livre, qui se lit comme un roman d’aventures à rebondissements multiples, réside d’ailleurs là, dans sa volonté de remonter à la source, de comprendre le sentiment d’exil qui irrigue une partie du peuple mexicain. A Ahuacatlán, bourgade nichée au cœur du massif montagneux de la Sierra Gorda, il a vu ce qui poussait tant de jeunes gens à l’exode, temporaire ou définitif : « la pauvreté (...), l’isolement qui [renforce] l’image fantasmée des Etats-Unis comme pays de cocagne, une agriculture très peu rentable et harassante qui [arrache] très tôt les enfants à l’école, les laissant inaptes à exercer un métier et rêveurs, bercés par une solution pour un enrichissement immédiat : El Norte ».
Pour troublant qu’il puisse être par moments, ce récit n’en réserve pas moins aussi quelques épisodes drolatiques. Par exemple, lorsque Ted Conover guide ses compagnons de route mexicains à l’aéroport de Phoenix et leur explique, au moment du contrôle aux portiques de sécurité, que le panier dans lequel ils sont tenus de déposer leurs effets personnels ne sert pas, comme à l’église, à faire la quête. Reflet typique de cette barrière culturelle à laquelle se heurtent tous les nouveaux venus, quelle que soit leur région d’origine – Guerrero, Michoacán, Sinaloa... Ou lorsque la méconnaissance de l’anglais conduit certains à commettre de savoureuses gaffes, tel Jesús confondant « moustache » et « mustard » (la moutarde) dans un restaurant Burger King.
D’un bout à l’autre de son voyage initiatique, de Los Angeles à la Floride, Ted Conover a su capter au plus près l’état d’esprit conquérant des clandestins avec qui il a voyagé et pour lesquels il a lui-même, à l’occasion, servi de coyote. A l’heure où l’Europe fait face à une vague d’immigration sans précédent, qui non seulement ne montre aucun signe de reflux, mais tend à s'amplifier, son enquête offre un regard bienvenu et utile. « Nous sommes habités par la peur rampante d’avoir oublié de fermer la porte du garage avant d’aller nous coucher », résume-t-il à propos de la crainte que suscite aux Etats-Unis « tout ce qui traverse la frontière ». A cette angoisse sourde, il oppose la raison et la finesse de son analyse de terrain. Une sage leçon d’humanité.
Aymeric Janier
(1) Les Coyotes, Editions Globe, octobre 2015, 384 pages.

2030 : le meilleur des mondes ?
10 août 2015
Art subtil et délicat que celui de la prospective, science par définition faillible. Anticiper les futures évolutions d’un pays, voire de la planète, requiert en effet lucidité et courage ; deux vertus dont l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne regrettait en son temps qu’elles manquassent cruellement à un Occident figé dans ses certitudes et miné par son goût immodéré pour les analyses trop conceptuelles.
Dans leur ouvrage 2030, le monde que la CIA n’imagine pas (1), paru en juillet, Thomas Flichy de La Neuville et Gregor Mathias, rattachés au Centre Roland Mousnier de l'université Paris IV-Sorbonne, se prêtent à l’exercice de manière convaincante. Dès les prolégomènes, les deux historiens, battant en brèche la « cécité intellectuelle » de l’agence de renseignement américaine, assument leur démarche : imaginer un futur possible, sans écarter les hypothèses « hardies » qui n’ont pas l’heur de plaire. Le pari pris – et relevé au fil des chapitres – est de susciter le débat, non de rassurer à outrance par des prophéties autoréalisatrices.
Ce monde de 2030, justement, à quoi ressemble-t-il ? Pour résumer, à un puzzle éclaté, en pleine recomposition. La plupart des grandes puissances actuelles sont passées du Capitole à la roche Tarpéienne. Ainsi en va-t-il des Etats-Unis qui, frappés par le déclin mais riches de leurs propres hydrocarbures grâce à l’exploitation des gaz et pétrole de schiste, en viennent à se désintéresser des affaires du monde. Fini la pax americana d’antan, la patrie de l’Oncle Sam se replie sur elle-même, sous le patronage du premier président latino de son histoire.
Cet isolationnisme rampant rabaisse l'ancienne première puissance mondiale au rang de simple spectatrice, comme dans ce scénario de crise fictif tissé dans l’ouvrage et prédisant, en septembre 2028, un affrontement entre l’Iran et l’Arabie saoudite à propos de Bahreïn – hypothèse d’autant plus réaliste qu’elle a déjà failli se concrétiser... en 2011. Le point de vue, certes abrupt mais rationnel, des auteurs tranche avec l'optimisme béat de la CIA, laquelle se discrédite en faisant l’impasse sur la menace islamiste et les fractures ethniques.
Considérée aujourd’hui par ses voisins comme une force aux appétits irrédentistes insidieux, la Chine de 2030, quoique puissante, ne serait pas non plus hégémonique. Les raisons ? Un développement « inégal et opaque », que ce soit entre les régions et le littoral ou entre les entreprises privées et celles d'Etat, ainsi qu'une politique démographique et écologique « suicidaire ». Du fait de ses atermoiements à propos du dogme de l'enfant unique (mis en place en 1979 par Deng Xiaoping) et de sa volonté de sacrifier l’environnement sur l’autel de la productivité, Pékin se trouverait fragilisé. Ce qui ferait le jeu de New Delhi.
L'Inde est d'ailleurs dépeinte dans le livre comme l'un des futurs acteurs majeurs de la scène internationale. Un affermissement dû à la conjonction d'une « démographie dynamique », d'une « résilience à la déstructuration sociale générée par la mondialisation » et, surtout, d'une « identité retrouvée », celle de l'hindouisme triomphant. A l'horizon 2030, alors que le slogan « L'Inde aux Hindous ! » fait office de mantra et alimente les persécutions antichrétiennes, le pays concentre 40 % de la richesse mondiale. Point noir : le développement, telle une sangsue, vampirise les ressources...
L'identité retrouvée représente également la matrice de la nouvelle Russie, autre pays en qui les deux historiens voient, sans doute à raison, une « puissance ascendante ». Dé-corrélée de Vladimir Poutine, dont le nom n'est cité qu'une fois, elle fonde sa force sur un corpus de valeurs aux antipodes de celles qui prévalent en Europe, gagnée par « le triomphe de l'individualisme, de l'organisation techniciste et du rejet du spirituel » – tendance du reste déjà perceptible aujourd'hui.
Sur le plan géopolitique, l'accessibilité accrue de la route du Nord-Est à travers le détroit de Béring, consécutive au réchauffement climatique, lui offre de nouvelles perspectives de rentabilité, quoiqu'au prix de certaines frictions avec la Chine. Sur son front occidental, Moscou voit aussi l'horizon s'éclaircir grâce à sa fusion avec la Biélorussie et à ses liens resserrés avec une Ukraine « amputée » territorialement, brisée économiquement et « lâchée » sans états d'âme par les Etats-Unis et l'Europe...
Mais c'est peut-être au Moyen-Orient, promis à un remodelage en profondeur en raison de l'isolationnisme américain, que les pistes esquissées par les auteurs sont les plus audacieuses. S'ils parient sur la balkanisation et l'appauvrissement des Etats arabes, au Sud, ils prédisent à la Turquie et plus encore à l'Iran un rayonnement grandissant – la première à travers une « union turcique » concurrente de l'Union européenne, le second en privilégiant une savante politique d'équilibre entre Ankara et New Delhi.
La République islamique pourrait même voir se rapprocher d'elle... Israël, l'ennemi atavique, devenu « la Hongkong du Proche-Orient ». Un choix plus raisonné que passionnel pour l'Etat « hébreu » (qui l'est de moins en moins), l'Iran étant, en 2030, le seul pays musulman où vit encore une communauté juive, écrivent-ils. Quant à l'autoproclamé Etat islamique, qui faisait régner la terreur au cours de la décennie 2010, il n'est plus qu'un lointain souvenir, « n'ayant pas résisté aux révolutions de palais en Arabie saoudite et au Qatar, qui ont réorienté le financement du terrorisme vers l'Afrique tropicale ».
Sur l'Afrique, justement, la boussole de Thomas Flichy de La Neuville et de Gregor Mathias indique, peut-être plus qu'ailleurs, une direction bien différente de celle privilégiée par les augures de la CIA dans les couloirs de Langley (Virginie). A rebours des oracles misant sur l’émergence d’une nouvelle opulence, eux sont convaincus que, dans quinze ans, le continent ressemblera à une « peau de panthère », parsemée de « petites taches de richesse dans un océan de pauvreté ». Crises de la faim, émeutes périodiques dans les bidonvilles, prédations étrangères : le tableau qu'ils dressent est sombre, sans nuance. Même le Nigeria et l'Afrique du Sud ne trouvent pas grâce à leurs yeux, menacés respectivement par une nouvelle guerre du Biafra et des inégalités encore plus fortes que sous le régime de l'apartheid.
L'Europe n'a pas non plus la faveur de pronostics favorables. Le vieillissement de sa population, couplée à une créativité en berne, l'a reléguée au second, voire au troisième plan. D'autant qu'en 2030 la culture du loisir prime tout le reste. Sur le Vieux Contient, fragmenté à l'excès, seule l'Allemagne s'en tire avec les honneurs, portée par son influence économique, mais aussi diplomatique, culturelle et militaire. L'étoile de Clausewitz pâlit, tandis que celle de Bismarck retrouve des couleurs...
Qu’en est-il de la France dans ce maelström ? En butte à des tensions sociales et à des revendications communautaristes exacerbées, elle offre un triste visage, celui d'une nation sénescente placée sous assistance financière par la Banque centrale européenne. Du système jacobin de jadis ne reste plus que ruine. Les régions ont pris le relais de l'Etat, sur fond d'explosion du système de retraite par répartition et de déchéance de l'éducation.
Tout au long de l'ouvrage, y compris dans sa dernière partie (construite en forme de conte fantastique reprenant les grandes tendances précitées), sourd une vision alarmiste du lendemain. Certes, le trait peut paraître forcé à certains moments – comme sur l'éclipse des Etats-Unis ou la puissance de l'axe indo-iranien – mais, pour les auteurs, rien n'est en soi inéluctable. Et de conclure : « L'avenir reste ouvert aux inflexions des minorités pensantes et agissantes. »
Aymeric Janier
(1) 2030, le monde que la CIA n’imagine pas, Bernard Giovanangeli Editeur, juillet 2015, 205 pages.

De la guerre clausewitzienne à la cyber-guerre
27 juillet 2015
Il y a encore trente ans, tout était, d’une certaine manière, très « normé ». La conduite de la guerre se résumait à un schéma classique, clausewitzien (1) : des belligérants clairement identifiés, s’affrontant sur un territoire géographique circonscrit, avec un arsenal plus ou moins conventionnel. La croissance exponentielle d'Internet a bouleversé la donne, mettant au rebut l’ordre westphalien des équilibres et rapports de force né au mitan du XVIIe siècle.
En se jouant des frontières physiques traditionnelles, le cyberespace, cette « interconnexion mondiale des réseaux servant à transmettre, à traiter ou à stocker les données numériques », a tracé de nouvelles perspectives. Un horizon chargé de promesses, mais aussi empreint de menaces. Au point que se pose désormais une question cruciale : l’humanité est-elle à l’aube d’un gigantesque conflit numérique ?
Dans un ouvrage collectif intitulé La première cyber-guerre mondiale ? (2) et paru en juillet, plusieurs experts issus des sphères publique et privée, rassemblés sous la houlette du criminologue Xavier Raufer, livrent quelques éléments de réflexion utiles – bien qu’assez techniques sur certains aspects – à propos des répercussions de la révolution numérique sur le monde tel que nous le connaissons.
Certes, estiment-ils, le champ du virtuel, dépourvu par essence de limite spatio-temporelle, offre un terreau fertile en matière de communication, d’accès à la connaissance, de croissance économique, de liberté ou encore de progrès scientifiques. Mais il porte aussi en germes le danger d'une infiltration pernicieuse par des « prédateurs, qu’ils soient criminels, terroristes, mercenaires ou guerriers ».
Pour les Etats modernes, l’enjeu est d’autant moins négligeable que le cyberespace, construit ex nihilo par la main de l’homme, brouille lignes et repères. Avec lui, ni « champ de bataille » ni « zone de sécurité prioritaire » ; le péril est ubiquitaire et intangible. Du moins jusqu'à un certain stade. Une cyber-attaque de grande ampleur pourrait, de fait, causer des dommages très concrets au pays qui en serait victime : paralysie de l’économie, destruction d’infrastructures vitales (aux niveaux énergétique et sanitaire), catastrophe écologique...
Conscientes de cette nouvelle réalité, les grandes puissances mondiales repensent progressivement leurs méthodes. Leur priorité : investir dans des cyber-armes, moins coûteuses, plus efficaces et difficilement « traçables ». Ces dernières années, les Etats-Unis et la Chine ont montré la voie. Mais, observent à raison les auteurs, il serait réducteur de se limiter au seul duel entre Washington et Pékin, dont les médias se repaissent à l’excès.
A leurs yeux, en effet, le principal théâtre de confrontation se trouve plutôt au Moyen-Orient, avec, comme acteurs centraux, Israël et l'Iran. La preuve ? Stuxnet et Flame, deux des plus puissants virus informatiques jamais élaborés, mis au jour en 2010 et 2012 par Kaspersky Lab (3). L'Etat hébreu, appuyé par les Etats-Unis, les aurait conçus dans le but de saboter les installations nucléaires iraniennes de Bouchehr et Natanz. Avec le succès que l'on sait.
Si la stratégie israélienne s’appuie sur un triptyque éprouvé – sensibilisation des jeunes aux problématiques cybernétiques, recherche scientifique et universitaire, sécurisation des systèmes d’information –, celle de la République islamique, en revanche, demeure lacunaire. Ce qui n’empêche pas Téhéran de perfectionner en secret sa force de frappe virtuelle dans le quartier beyrouthin de Dahiyeh, tenu par la milice chiite du Hezbollah...
En croissance perpétuelle, le cyberespace a, par son opacité et sa plasticité, fait naître de nouvelles règles. Fini les concepts éculés liés à la guerre traditionnelle d’antan, place désormais aux conflits sans début ni fin marqués, aux duels à l'asymétrie renforcée où la différence de pouvoir entre « grands » et « petits » tend à s’effacer ; un cadre « plus propice aux attaquants qu’aux défenseurs ». Les fous d’Allah l’ont bien compris, qui déversent leur logorrhée empoisonnée sur les réseaux sociaux. Comme le résume Jean-Pierre Filiu, spécialiste de l’islam contemporain cité dans l’ouvrage : « La Toile est pour le djihad global le vecteur privilégié de diffusion d'une vulgate homicide qui réduit quatorze siècles de tradition islamique à une poignée de citations assénées en boucle et hors de leur contexte. »
Les hiérarques d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden en tête, avaient très tôt perçu le rôle providentiel que pouvait jouer Internet dans la conduite du djihad, notamment pour donner davantage d’écho à leur propagande. Coûts de matériel réduits, absence de censure, capacité de diffusion mondiale : les avantages potentiels étaient nombreux.
Aujourd’hui, le groupe Etat islamique (EI) – dont on peut regretter qu’il ne soit évoqué nulle part, tant sa capacité de nuisance numérique est de loin supérieure à celle d’Al-Qaïda – a pris la relève des vétérans de la guerre sainte. Comment lutter ? En partant du principe que « le cybermonde d'octets est une partie intégrante de tous les autres milieux (aérien, maritime, terrestre, spatial) », d’abord et avant tout – rappel salutaire. En se préparant au combat, ensuite. Ce qui implique « d’être dynamique, de réduire (sa) vulnérabilité, de mener une défense (pro)active, de gérer les menaces et de faire preuve de résilience ». Des pistes intéressantes abordées dans le livre, mais seulement à la marge.
Comme l’expliquent avec justesse les auteurs, le cyberespace, dans lequel se meuvent désormais près de quatre milliards d’internautes (dont un milliard de Chinois), s'est mué en un territoire politique et idéologique qu'il est important d'investir et de conquérir, au nom de « tous ceux qui ont une certaine idée de l’homme ». Une cyber-guerre pour mieux préserver l'esprit des Lumières face aux démons sans cesse renaissants de l'obscurantisme...
Aymeric Janier
(1) La guerre clausewitzienne [en référence au général et théoricien militaire prussien Carl von Clausewitz (1780-1831)] s'appuie sur le principe de souveraineté des nations et sur la codification de leurs rapports par le droit international, y compris le droit de la guerre.
(2) La première cyber-guerre mondiale ?, ouvrage collectif coordonné par Xavier Raufer, MA Editions, juillet 2015, 205 pages.
(3) Kaspersky Lab est une société spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. Elle a été fondée en 1997. Son siège social se trouve à Moscou.
Pour aller plus loin : lire « Géopolitique du cyberespace », grand dossier de la revue Diplomatie (octobre-novembre 2014).

Le « printemps arabe », radiographie d’une révolte
5 mars 2015
Il a fait naître des craintes, des doutes, des fantasmes. Des contrevérités, aussi. Depuis son émergence spontanée à Sidi Bouzid (centre de la Tunisie), à la fin de décembre 2010, le « printemps arabe », vaste mouvement de contestation populaire ayant secoué l’un des carcans les plus rigides de la planète, a suscité maints commentaires et une prose féconde de la part des chercheurs, des journalistes et des universitaires. Mais jamais encore il n’avait été examiné à travers le prisme, ô combien éclairant, de la géopolitique.
Avec son ouvrage, sobrement intitulé Géopolitique du printemps arabe (1), Frédéric Encel, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à l’ESG Management School, a tenu à réparer cette injustice en se livrant à une analyse didactique dépassionnée d’un phénomène qui a pris tous les observateurs de court et s’est rapidement distingué par sa portée hors norme, tant du point de vue du nombre des acteurs engagés que de son impact politico-diplomatique.
Renvoyant dos à dos, dès son propos liminaire, les « cyniques » – nostalgiques patentés des dictatures déchues – et les « complaisants » – tolérants, voire favorables à diverses formes d’islamisme rétrograde –, l'auteur s'efforce de décrire, « avec rigueur et réserve », les ressorts de ce mouvement revendicatif à la fois acéphale et protéiforme, inédit depuis l’ère des indépendances (1940-1960). Lequel, prend-il soin de préciser, n’est pas sans rappeler le printemps des peuples de 1848, qui avait mis aux prises populations et pouvoirs autoritaires sur le Vieux Continent.
Si les germes du printemps 2011 ont pu éclore, cela tient à la conjugaison de divers facteurs. Certes, l'exaspération sociale, le marasme économique et la sclérose politico-institutionnelle ont joué un rôle crucial dans le basculement vers la révolte. Mais cela n’explique pas tout. Frédéric Encel y voit aussi la conséquence d’un monde arabe en pleine crise d’identité, perclus de ressentiment à l'idée « de ne pas participer à la marche du monde, ou alors comme objet plus que comme acteur ».
Une perception d’ostracisme qui, elle-même, nourrit – en l’amplifiant – la paranoïa du complot et de l’antisémitisme. Et le géopolitologue de citer des exemples aussi ubuesques (mais authentiques) que le tsunami asiatique de 2004, « qui aurait été créé par un gigantesque vibrateur sous-marin posé par les ‘sionistes’ » ou « les chewing-gums aphrodisiaques que le Mossad [le service de renseignement extérieur israélien] aurait distribués aux femmes en Haute-Egypte pour épuiser et humilier leurs maris » !
Parsemé de références historiques utiles, l’ouvrage s’attache à explorer les raisons des soulèvements populaires qui ont abouti à la chute de potentats réputés inamovibles tels que Mouammar Kadhafi en Libye, Hosni Moubarak en Egypte ou encore Ali Abdallah Saleh au Yémen. Les principaux ferments de la colère ? Ici « l’intolérable captation des richesses », là « le ras-le-bol de la gérontocratie dynastique », là encore « les revendications tribalistes et/ou régionalistes ». Autant de « moteurs » alimentés en sus par le « travail de sape » de la chaîne de télévision qatarienne Al-Jazira, qui n’a pas ménagé sa peine pour brocarder la « langue de bois épaisse » de ces satrapes.
Il faut aussi savoir gré à Frédéric Encel d’avoir, sans dogmatisme, rappelé quelques réalités indiscutables : non, le « printemps arabe » n’est en rien le corollaire du conflit israélo-palestinien. Pas plus qu’il n’est une sorte d'effondrement du Mur de Berlin, dans la mesure où l'opposition est venue d'en bas, et non d’en haut comme en 1989. Pas de démiurge arabe à la manœuvre pour promouvoir, comme Mikhaïl Gorbatchev en son temps, une quelconque glasnost (transparence) ou perestroïka (restructuration) de grande ampleur...
Avec un louable souci de pédagogie, qui sert de fil conducteur à son opuscule, le disciple du grand géopolitologue Yves Lacoste nous éclaire sur les raisons pour lesquelles certaines contrées n’ont pas été balayées par le vent de l’insurrection, qu’il s’agisse de la volonté de ne pas revivre les heures sombres d’un passé traumatisant (Algérie), d’une certaine « invulnérabilité » liée au prestige dynastique (Maroc) ou de la capacité à acheter la paix sociale à coups de pétrodollars (Arabie saoudite).
Touchées, à l’inverse, de plein fouet, l’Egypte et surtout la Syrie font l’objet d’une attention particulière. Car, dans ce dernier cas, comment expliquer qu'après quatre ans d'une guerre civile particulièrement sanglante (plus de 220 000 morts), Bachar Al-Assad soit toujours solidement arrimé au pouvoir ? Question de résilience, « d’extrême constance dans l’adversité »... ainsi que de soutiens utiles venus d’Iran et de Russie, avance l’auteur.
Et que dire des autres puissances ? A l’instar de leurs services de renseignement, largement dépassés, elles ont failli. L’Europe, les grands émergents (Brésil, Inde), mais aussi les Etats-Unis qui, trop accaparés par d'autres dossiers brûlants (rivalité indo-pakistanaise, différend sino-japonais en mer de Chine et, plus récemment, crise ukrainienne) ont détourné le regard. Un abandon vécu comme une trahison, alors que Barack Obama, dans son discours du Caire du 4 juin 2009, avait promis de retisser les liens avec le monde arabo-musulman ; sorte de « New Deal » destiné à laver les stigmates de l'ère Bush Jr.
A présent que le premier chapitre des révoltes de 2011 est refermé (il s'est achevé avec l'élection triomphale d'Abdel Fattah Al-Sissi à la présidence de l'Egypte, en juin 2014), s'ouvre une nouvelle période d'incertitude institutionnelle et territoriale. Cette instabilité promet d'être d'autant plus prégnante qu'elle se double de « déchirures » aux conséquences potentiellement ravageuses : « sunnites contre chiites », « nationalistes contre islamistes » et même « islamistes contre... islamistes ».
Dans ce contexte, faut-il désespérer du « printemps arabe » ? Prudent, Frédéric Encel rappelle que nulle démocratie n'a été bâtie en un jour. Et reconnaît le mérite de ceux, hommes et femmes, qui se sont élevés (et sacrifiés) face à la tyrannie : « Leur succès fut et demeurera d'avoir posé un jalon historique, non pas théorique mais tout à fait concret...»
Aymeric Janier
(1) Géopolitique du printemps arabe, de Frédéric Encel, Presses universitaires de France (PUF), octobre 2014, 241 pages.

Glossaire (extrait de « Cher Leader »)
Admis : Le petit cercle d’élus parmi l’élite, dont Kim Jong-il a personnellement requis la présence et qui ont passé plus de vingt minutes avec lui derrière des portes closes.
Chosŏn du Sud : Nom nord-coréen servant à désigner la Corée du Sud.
DFU : Département du Front uni : section clé du Parti des travailleurs qui supervise la diplomatie, l’élaboration des politiques et l’espionnage intercoréens.
DMZ : Zone coréenne démilitarisée : ligne d'armistice qui divise la péninsule coréenne depuis 1953.
DOC : Département de l’Organisation et du Conseil : chaîne de commandement exécutif du Parti des travailleurs.
DPA : Département de la Propagande et de l’Agitation.
Juche : Philosophie nord-coréenne ratifiée par l’Etat et fondée sur le principe d’autosuffisance [le « père » de cette doctrine, Hwang Jang-yop, a demandé l’asile politique en Corée du Sud en 1997].
Localisation : Politique du DFU (département du Front uni) d'imprégnation des façons de penser sud-coréennes afin d'influencer la Corée du Sud.
RPDC : République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord).
Songun : Politique de priorité à l’armée (APK).
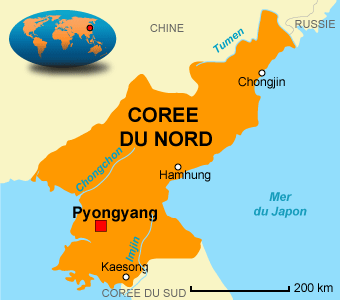
Ode à la liberté d’un transfuge nord-coréen de haut rang
9 décembre 2014
Il est des moments qui marquent à jamais la vie d’un homme. Celui que relate Jang Jin-sung en ouverture de Cher leader (1) nous plonge sans préavis dans la Corée du Nord de feu Kim Jong-il ; un monde mi-kafkaïen, mi-orwellien, pétri de codes, où « double langage et opacité » forment l’ossature d’une implacable machine broyeuse de consciences. Ce jour de mai 1999, le jeune poète, aujourd’hui installé en Corée du Sud, reçoit en pleine nuit une « convocation extraordinaire » du premier secrétaire du Parti des travailleurs. Direction... l’inconnu.
Au terme d’un périple de plusieurs heures en train puis en bateau, au cours duquel il est guidé par des cerbères en armes à la mine peu avenante, le voici au cœur d’une salle « d’au moins mille mètres carrés », se tenant, hiératique, aux côtés d'autres « camarades » dans l'attente du « Général ». Cette rencontre avec le « Cher Leader », ce chef censément omnipotent et thaumaturge dont les médias exaltent les mérites, se révèle décevante. Le dirigeant nord-coréen n’a rien d’un surhomme. Perché sur des talonnettes de six centimètres, il se montre davantage préoccupé par le bien-être de son chien que par celui des zélotes qui l'entourent. Qui plus est, il s'exprime dans une langue peu châtiée, malmenant la syntaxe.
Le maître de Pyongyang, néanmoins, a droit de vie et de mort sur ses sujets. Jang Jin-sung, convié pour avoir composé un poème qui lui a beaucoup plu (« Le Printemps repose sur le canon du Seigneur »), l'apprend vite à ses dépens, lorsqu’il lui glisse d'un air ironique : « C’est quelqu’un qui l’a écrit à ta place, n’est-ce pas ? N'essaie pas de me mentir. Je te ferai exécuter. » La soumission par la terreur... Grâce à ses écrits, Jang Jin-sung devient un intouchable – un « Admis », selon la terminologie en vigueur au nord du 38e parallèle. Une nouvelle vie, faite de passe-droit et de prébendes à la chaîne, s’offre à lui du jour au lendemain. « C’est à peu près comme si j’avais gagné à la loterie dans un pays capitaliste. »
Au fil de son récit, parsemé de détails souvent édifiants pour un lecteur occidental, il évoque sa mission au sein du département du Front uni (DFU), une branche clé du Parti des travailleurs, l’antre de la propagande d’Etat. Dans le secret feutré de la section V (littérature), division 19 (poésie), bureau 101 s’élaborent la matrice de la guerre psychologique à la nord-coréenne et la prose ubéreuse du régime relayée servilement par le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti. Ceux qui y travaillent ont un objectif assigné : s’imprégner du « psychisme collectif de Chosŏn du Sud [la Corée du Sud] afin de mieux le saper et d'en triompher ». « Nous devions être des poètes sud-coréens partisans de Kim Jong-il. »
Entre ces hauts murs, totalement impénétrables aux non-initiés, Jang Jin-sung s'attelle à la tâche avec minutie, sous le pseudonyme de Kim Kyong-min. A l’insu de ses compatriotes, il dévore avec avidité la presse et la littérature sud-coréennes pour mieux tresser les louanges des Kim et de leurs politiques, notamment celles du songun (priorité à l'armée) et du juche, fondée sur l’autosuffisance (voir glossaire ci-contre). Sa plume, féale et lyrique, le propulse au premier plan. Jusqu’à ce qu’un voyage à Sariwon, sa ville natale, lui ouvre les yeux sur la triste réalité d’un pays où la population, minée par la famine, se meurt à petit feu.
Le propos de Jang Jin-sung prend alors un tour plus incisif. Il décrit avec sensibilité cette fêlure qui, peu à peu, s’étend et brise le carcan de ses certitudes. La prise de conscience est violente. Notamment lorsqu’il assiste à l’exécution, sur la place publique, d’un agriculteur affamé qui avait volé du riz. Un homme travaillant la terre, mais n’ayant pas de quoi se sustenter : cruel paradoxe pour la patrie du « socialisme triomphant ». Au temps des doutes succède celui de la tentation de l'interdit. Après avoir commis la lourde erreur de prêter à l'une de ses connaissances un ouvrage prohibé, Jang Jin-sung est confronté à un dilemme cornélien : l’exil ou la mort. Le choix sera rapide. Ce sera l’exil par la Chine, la frontière terrestre avec la Corée du Sud – matérialisée par une zone tampon (DMZ) étroitement surveillée – étant infranchissable.
L’ouvrage, bâti comme un roman, évoque pudiquement, mais sans omission, cette douloureuse quête d’affranchissement. Les péripéties s’enchaînent : la traversée du fleuve Tumen gelé, sous la menace permanente des balles nord-coréennes, avec Young-Min, un compagnon d’infortune ; le sombre jeu de cache-cache avec les autorités chinoises (et les agents nord-coréens) ; les moments d’intense solitude dans le froid et de profonde amertume quand la liberté tant recherchée se trouve à portée de main, mais se refuse au dernier moment.
Et puis, il y a le choc de la découverte de la Chine elle-même. De son gigantisme, de son « ouverture », de son « audace à défier les ténèbres de la nature ». « Dans l'obscurité de la Corée du Nord, les seuls endroits illuminés 24h/24 étaient les alentours d'une statue de Kim Il-sung [le père fondateur du régime, mort en 1994]. Là-bas, lumière signifiait pouvoir », explique l’auteur. Par-delà les frontières de la RPDC, une nouvelle vérité pénètre son esprit. Un à un, les mythes et illusions créés par Pyongyang s'évaporent. Telle cette croyance confondante de naïveté (ou de mégalomanie) que « le peuple nord-coréen est le plus glorieux de la Terre ».
Alors que progresse pas à pas son périple vers le Sud, Jang Jin-sung, en sa qualité de transfuge de haut rang, lève le voile sur le monde énigmatique et ténébreux des Kim ; ce système cadenassé de l’intérieur, où prévaut l’art consommé de la duperie et des faux-semblants. Il révèle notamment les dessous méconnus de la transition entre Kim Il-sung et Kim Jong-il. Une succession prétendument héréditaire, selon la version officielle, mais qui, en réalité, se serait faite sur fond « d’actes de terreur, de trahison et de vengeance ».
Dès 1982, le fils aurait en quelque sorte « tué le père » en s’arrogeant tout le pouvoir de l'Etat « grâce aux tentacules du DOC [le département de l'Organisation et du Conseil], dont chacun des postes significatifs était occupé par d’anciens camarades d'université ». Etouffé par cette emprise irrésistible, Kim Il-sung n’aurait conservé, dans ses dernières années, que de maigres oripeaux d’autorité, même si son peuple, ignorant tout de ces obscures intrigues de palais, continuait de lui vouer un culte absolu, quasi messianique.
Aidé par la Providence, Jang Jin-sung a fini par s’extirper des griffes de cet univers féroce pour rejoindre Séoul, comme plus de 25 000 de ses compatriotes. En décembre 2004, après de longs mois d’interrogatoire par les services de renseignement, il a acquis la citoyenneté sud-coréenne. Devenu l’un des plus farouches dissidents de la dynastie des Kim, il vit toujours sous protection policière. Car Pyongyang rêve secrètement de l'éliminer pour laver l’affront de sa trahison. L'homme, il est vrai, en sait beaucoup. Et n’a pas renoncé à son combat, par égard pour ceux qui n'ont pas eu l'heur de fuir : « Je ne trouverai la paix qu’en faisant la guerre au despotisme (...) Sans cela, le privilège de ma liberté ne serait rien d'autre que de l'égoïsme. Si ce régime entretient un arsenal de (...) bombes nucléaires, l'arme que je brandis est la vérité. » Un pari insensé ?
Aymeric Janier
(1) Cher Leader, de Jang Jin-sung, Editions Ixelles, octobre 2014, 366 pages.

Glossaire abrégé
Aman (Agaf Hamodiin) : Service de renseignement militaire israélien, également chargé de la censure militaire et de la sécurité de l'information.
Kidon (« baïonnette », en hébreu) : Branche du Mossad supervisant les éliminations physiques et les enlèvements.
Mossad (ou Hamisrad, « le bureau ») : Institut pour le renseignement et les affaires spéciales – Service de renseignement extérieur de l'Etat hébreu, rattaché directement au premier ministre.
Sayeret Matkal : Unité de reconnaissance et d'action spéciale de l'état-major des armées, elle est considérée comme la meilleure unité de combat de l'armée israélienne. Elle fut connue un temps sous l'appellation d'unité 269 ou encore d'unité 424.
Shayetet 13 : Unité spéciale de la marine israélienne (Heyl Hayam). Elle est également connue sous les dénominations de Flottille n°13, S'13 ou Kommando Yami.
Shin Beth (Sherout Ha-Bitachon Ha-Klali) : Service de sécurité général chargé de la lutte antiterroriste et du contre-espionnage sur le territoire israélien, ainsi que de la protection des personnalités, des ambassades et de la compagnie aérienne El Al. Il est également appelé Shabak.
Tsahal (Tsva Haganah Le-Israel, « Forces de défense d'Israël ») : L'armée israélienne.
Unité 8200 : Unité militaire spécialisée dans l'interception des communications adverses, la surveillance d'Internet et la guerre cybernétique offensive.
Israël : le renseignement, art de l'ombre et gage de survie
22 juillet 2014
Depuis sa naissance, en mai 1948, sous l'impulsion de son « père fondateur », David Ben Gourion, Israël a grandi dans un environnement régional empreint d'incertitude et de volatilité. Desservi par son absence de profondeur stratégique et sa faiblesse démographique, l'Etat hébreu s'est efforcé, dès le départ, de pallier ces lacunes potentiellement fatales en misant sur le haut degré de professionnalisme de ses services secrets. Cela est d'autant plus patent – et nécessaire – aujourd'hui qu'il est en butte à l'hostilité de la plupart de ses voisins, ainsi que d'une vaste galaxie d'acteurs non étatiques voués à sa destruction (Hamas et Jihad islamique en Palestine, Hezbollah au Liban, pour les plus connus).
Plus encore que son intégrité territoriale, Israël cherche à assurer sa survie grâce à une culture poussée du renseignement, dont les origines remontent à l'Ancien Testament, et notamment à « la tradition commerçante et diasporique du peuple juif », propice à la création de « réseaux ». C'est à une plongée dans ce monde de l'ombre, obscur maelström d'espions tout-terrain, de complots et de trahisons, que nous convient Eric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R), et David Elkaïm, chercheur au CF2R et chargé de conférences à Sciences Po.
Dans leur récent ouvrage, Les Services secrets israéliens : Aman, Mossad et Shin Beth (1), richement documenté, ils privilégient une approche didactique et, surtout, dépassionnée. Loin de faire le panégyrique d'un appareil sécuritaire israélien fort complexe, ils préfèrent au contraire en disséquer méticuleusement les ressorts, sans a priori. Il ne s'agit pas de poser un regard critique sur la politique menée par le gouvernement conservateur de Benyamin Nétanyahou, mais plutôt de comprendre pourquoi et comment l'Etat hébreu s'est construit, au fil des années, une solide armure à même de repousser les assauts extérieurs.
Fait inédit, les deux chercheurs ne s'intéressent pas uniquement au Mossad, le service de renseignement extérieur créé au printemps 1951, que les médias occidentaux placent tantôt sur un piédestal, tantôt sur la sellette, au gré des circonstances. Ils décortiquent également de manière approfondie l'organisation et le fonctionnement du Shin Beth (ou Shabak, l'organe responsable de la sécurité intérieure et du contre-espionnage), de l'Aman (le renseignement militaire) et des corps de forces spéciales, à l'instar du Sayeret Matkal, la meilleure unité de combat de Tsahal, ou du Shayetet 13, l'élite de la marine israélienne, souvent comparée aux redoutables Navy Seals américains.
De surcroît, cette radiographie détaillée donne à voir les méthodes prisées par les hiérarques du renseignement israélien pour faire pièce aux menaces les plus inquiétantes, qu'il s'agisse de l'infiltration d'agents en territoire ennemi, d'opérations clandestines, d'assassinats ciblés (pudiquement appelés « traitements négatifs ») ou encore de raids de commandos. La notion de « guerre préventive », dont l'ancien premier ministre Menahem Begin se fit le chantre pour justifier la destruction du réacteur nucléaire irakien d'Osirak en juin 1981 (opération « Opéra »), n'est pas oubliée. Dans un pays où « perdre la guerre n'est pas une option », en effet, elle revêt une importance capitale.
Cette approche prophylactique, couplée à une détermination sans faille, a permis aux différentes branches du renseignement israélien d'enregistrer de nombreux succès, parmi lesquels l'assassinat de Mustafa Hafi, le chef des services secrets égyptiens dans la bande de Gaza, en 1956 (première élimination ciblée de l'Etat hébreu), et celui d'Imad Mughniyeh, l'un des dirigeants du Hezbollah, en 2008. Au-delà de ces « victoires » symboliques – auxquelles appartiennent la guerre des Six-Jours (1967) et l'opération « Colère de Dieu » contre les auteurs directs et indirects du massacre des Jeux olympiques de Munich (1972) –, Israël a aussi essuyé des échecs parfois cinglants.
Eric Denécé et David Elkaïm en dressent une liste certes non exhaustive – erreur d'appréciation précédant la guerre du Kippour (1973), tentative d'assassinat manquée de Khaled Mechaal, chef du bureau politique du Hamas, en Jordanie (1997) – mais qui contribue salutairement à battre en brèche certains fantasmes : non, le renseignement israélien n'est pas infaillible, pas plus qu'il n'est à l'abri de certaines dérives. En témoignent le scandale Ben Barka (1965), du nom de l'opposant marocain à Mohammed V puis Hassan II enlevé à Paris devant la brasserie Lipp, ou l'affaire du bus 300 (1984), lorsque deux terroristes palestiniens, blessés, furent froidement exécutés par les hommes du Shin Beth, à l'instigation de son directeur de l'époque, Avraham Shalom.
Animés par un louable souci de prospective, les deux auteurs n'occultent pas non plus le renseignement électronique, appelé à jouer un rôle déterminant dans les années à venir, notamment face à l'Iran. Responsable de ce domaine ultrasensible, l'unité 8200 (rattachée à l’Aman) jouit d'ailleurs d'un budget très confortable, l'un des plus importants de Tsahal, et s'appuie sur un personnel hautement qualifié, « seuls les surdoués de la programmation et de l'algorithmique y [ayant] accès ». Ces « grandes oreilles » ne représentent plus un luxe superfétatoire à l'heure où Israël, régulièrement sujet à des poussées de fièvre obsidionale, est confronté à la multiplication des offensives ennemies sur la Toile et les réseaux sociaux.
Dans ce contexte abrasif, où le péril peut venir tant du champ de bataille militaire que du cyberespace, à quoi pourrait ressembler l'avenir du renseignement israélien ? A cette question aussi, Eric Denécé et David Elkaïm ont une réponse toute personnelle. Pour eux, aucun doute, « les héros des guerres futures d'Israël ne seront pas des équipages de chars Merkava, des fantassins couverts de poussière ou des pilotes survolant le Proche-Orient à Mach 2. Ce seront d'abord des geeks technophiles et les pirates informatiques de l'unité 8200, bombardant leurs patrons d'idées, lançant le développement de nouveaux logiciels et de nouveaux systèmes électroniques ».
Aymeric Janier
(1) Les Services secrets israéliens : Aman, Mossad et Shin Beth, d'Eric Denécé et David Elkaïm, Editions Tallandier, avril 2014, 395 pages.